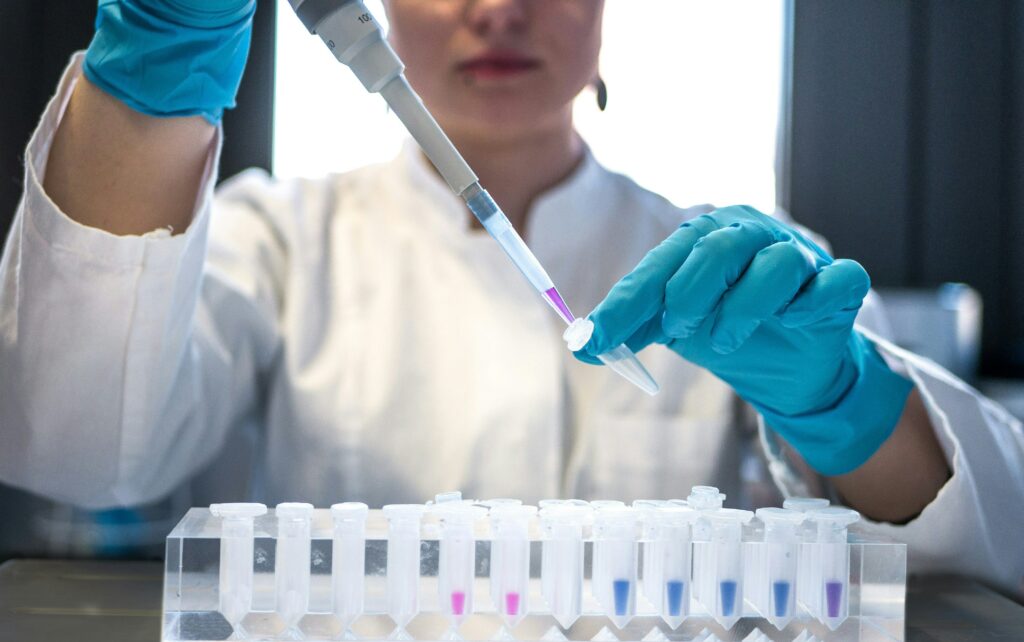Le test OCDE 408 est une méthode de référence pour évaluer les effets d’une exposition orale prolongée à une substance chimique. Reconnue à l’échelle internationale, cette étude de toxicité subchronique constitue une étape essentielle dans l’évaluation du danger et du risque pour la santé humaine.
Développée par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la ligne directrice 408 s’intègre dans les protocoles réglementaires exigés pour l’enregistrement ou l’évaluation de substances chimiques, pharmaceutiques, agroalimentaires, cosmétiques ou encore de matériaux. En simulant une exposition orale répétée sur 90 jours chez les rongeurs, elle permet de caractériser les effets potentiellement nocifs d’un composé à moyen terme, et de définir les seuils critiques tels que la dose sans effet nocif observé (NOAEL). Reconnue à l’échelle mondiale, cette méthode harmonisée s’inscrit dans une approche graduée de la toxicologie réglementaire et alimente les dossiers REACH, les notifications aux agences sanitaires ou les évaluations de sécurité produit.
Table des matières
Objectifs et principe général du test OCDE 408
Identifier les effets systémiques d’une exposition répétée
Le principal objectif du test OCDE 408 est de déterminer les effets indésirables qui pourraient apparaître à la suite d’une exposition quotidienne à une substance chimique par voie orale sur une période de 90 jours. Cette durée correspond à une exposition subchronique, c’est-à-dire à moyen terme, permettant d’identifier des effets qui ne seraient pas observables lors d’une exposition courte (comme dans les études de 14 ou 28 jours).
La répétition quotidienne de l’exposition permet de détecter l’éventuelle accumulation de la substance ou de ses métabolites dans l’organisme. Elle contribue aussi à identifier des effets progressifs ou retardés, que seule une étude prolongée peut mettre en évidence. Le test permet notamment d’observer l’impact de la substance sur le métabolisme, les organes internes, les paramètres biochimiques et l’état général de santé des animaux.
Déterminer un NOAEL et une relation dose-réponse
Un des résultats majeurs attendus de cette étude est la détermination d’un NOAEL (No Observed Adverse Effect Level), c’est-à-dire la dose maximale à laquelle aucun effet toxique significatif n’est observé chez les animaux testés. Ce paramètre est indispensable dans l’évaluation des risques pour la santé humaine, puisqu’il permet de calculer des marges de sécurité et d’établir des limites d’exposition tolérables.
Le protocole est conçu pour établir une relation dose-effet. Trois groupes reçoivent des doses croissantes du composé étudié, en plus d’un groupe témoin qui ne reçoit aucun traitement ou seulement le véhicule (support neutre). L’analyse comparative entre ces groupes permet de détecter les effets liés à la dose et d’en évaluer l’intensité et la fréquence. Cette relation dose-réponse est un critère fondamental pour confirmer la toxicité d’une substance.
Cibler les organes et systèmes physiologiques affectés
Le test OCDE 408 ne se limite pas à une observation générale de l’état de santé. Il vise également à identifier les organes cibles de la toxicité. Grâce à une combinaison d’examens cliniques, biologiques, histopathologiques et comportementaux, les chercheurs peuvent détecter les effets spécifiques de la substance sur des systèmes physiologiques précis : foie, reins, système nerveux, appareil digestif, glandes endocrines, appareil reproducteur, etc.

Mise en œuvre expérimentale du test
Espèces animales utilisées et conditions d’élevage
Le test OCDE 408 est principalement réalisé sur des rongeurs, avec une préférence pour le rat, dont les réponses physiologiques sont bien documentées et largement utilisées comme modèle prédictif pour l’humain. Les souris peuvent être utilisées dans certains cas, mais uniquement si cela est scientifiquement justifié.
Chaque groupe de traitement doit comporter au moins 10 mâles et 10 femelles, afin de permettre l’analyse des différences liées au sexe. Les animaux doivent appartenir à des souches standardisées, issues de colonies saines, sans pathologie préexistante, et dont l’âge et le poids sont homogènes.
Les conditions d’élevage doivent être parfaitement contrôlées tout au long de l’étude. La température est généralement maintenue entre 22 °C ± 3 °C, avec une humidité relative comprise entre 30 % et 70 %, et un cycle lumineux de 12 heures jour / 12 heures nuit. Les animaux sont hébergés dans des cages adaptées, avec une litière absorbante et un accès à une alimentation standardisée sans phytoestrogènes, ainsi qu’à de l’eau potable ad libitum. Ces conditions garantissent une stabilité physiologique et limitent les biais expérimentaux.
Voies et modalités d’administration
La substance à tester est administrée quotidiennement par voie orale pendant toute la durée de l’étude, soit 90 jours consécutifs. Trois voies d’administration sont autorisées : le gavage (introduction directe dans l’estomac à l’aide d’une sonde), l’incorporation dans l’alimentation, ou la dilution dans l’eau de boisson.
Le choix de la voie dépend des propriétés physico-chimiques du composé, mais aussi du scénario d’exposition réaliste auquel un être humain pourrait être confronté. Le gavage est souvent privilégié pour garantir un dosage précis, notamment lorsqu’il s’agit de formulations liquides ou instables. L’alimentation ou l’eau de boisson sont plus pertinentes pour simuler une exposition chronique à faibles doses.
Le volume administré ne doit pas dépasser les capacités physiologiques de l’animal, et les solutions doivent être préparées selon des procédures rigoureuses, avec une homogénéité et une stabilité vérifiées à chaque étape. Une attention particulière est portée à la traçabilité de la substance : numéro de lot, conditions de stockage, concentrations préparées et consommées, sont systématiquement enregistrés.
Sélection des doses et test limite
La détermination des niveaux de dose repose sur les résultats d’essais antérieurs, comme le test de toxicité aiguë ou le test OCDE 407 à 28 jours. L’objectif est de couvrir un éventail de réponses, incluant une dose élevée provoquant des effets toxiques, une dose intermédiaire, et une dose faible qui, idéalement, n’induit aucun effet mesurable.
Trois groupes testés sont constitués, en plus d’un groupe témoin recevant soit aucun traitement, soit uniquement le véhicule (ex. : eau, huile, solution neutre). Le protocole prévoit également la possibilité de réaliser un test limite à 1000 mg/kg/jour, dans les cas où aucun effet toxique n’est attendu en raison des propriétés connues de la substance ou d’analogues structurels.
Le test limite est utile pour simplifier l’étude lorsque l’exposition humaine est faible ou contrôlée, mais ne remplace pas un protocole complet si les résultats indiquent des effets potentiels ou si l’exposition environnementale est significative. Dans tous les cas, la sélection des doses doit éviter toute souffrance inutile et respecter les principes éthiques de réduction, raffinement et remplacement (3R) dans l’expérimentation animale
Vous recherchez une analyse ?

Paramètres évalués tout au long de l’étude
Suivi clinique quotidien et hebdomadaire
Les animaux sont observés au minimum une fois par jour, à heure fixe, pour détecter tout signe de souffrance, de détérioration de l’état général ou de modification du comportement. Les signes cliniques recherchés incluent la posture anormale, les troubles locomoteurs, les difficultés respiratoires, la perte de réflexes, les convulsions ou la prostration.
Le poids corporel est mesuré une fois par semaine, tout comme la consommation de nourriture et d’eau. Ces données permettent de suivre l’évolution de la croissance et du métabolisme, et de repérer d’éventuelles réductions de l’appétit ou une déshydratation, qui peuvent être des indicateurs précoces de toxicité.
Les examens fonctionnels hebdomadaires peuvent inclure des tests de réactivité, de motricité et d’équilibre. Ils complètent les observations générales en apportant des informations sur le système nerveux central et périphérique.
Analyses fonctionnelles et biologiques
Plusieurs types d’analyses sont effectués au cours de l’étude, en particulier dans la phase finale. Elles visent à documenter les effets du composé sur les paramètres sanguins, les fonctions hépatiques, rénales, électrolytiques et métaboliques.
Les analyses hématologiques comprennent la mesure de l’hématocrite, de l’hémoglobine, du nombre de globules rouges et blancs, de la formule leucocytaire, ainsi que le comptage des plaquettes et l’étude des paramètres de coagulation.
Les analyses biochimiques sont réalisées sur le sérum ou le plasma, avec un panel complet incluant : le glucose, l’urée, la créatinine, les transaminases hépatiques (ALT, AST), la phosphatase alcaline (ALP), le cholestérol total, les fractions HDL et LDL, les triglycérides, les protéines totales, l’albumine, le sodium, le potassium, le calcium et le phosphore.
Une analyse d’urine est souvent ajoutée pour étudier les fonctions rénales. Elle peut inclure des mesures du pH, de la densité, de la présence de glucose, de protéines, de corps cétoniques, de sang ou de leucocytes, ainsi qu’un examen microscopique du sédiment.
Paramètres endocriniens et reproductifs
Depuis 2018, la ligne directrice OCDE 408 inclut des paramètres endocriniens, en particulier ceux liés à la fonction thyroïdienne. Les hormones dosées sont la thyroxine (T4), la triiodothyronine (T3) et la thyréostimuline (TSH). Ces mesures permettent de détecter des perturbations hormonales précoces, qui pourraient refléter une activité endocrinienne de la substance testée.
Dans certains cas, notamment en fonction du profil toxicologique de la substance, des dosages hormonaux complémentaires sont effectués pour explorer la fonction reproductive. Il peut s’agir de la testostérone, de l’estradiol, de la FSH (hormone folliculo-stimulante) et de la LH (hormone lutéinisante). Ces dosages sont réalisés à des moments précis pour limiter les variations dues au cycle circadien, au stress ou au cycle œstral chez les femelles.

Nécropsie, histopathologie et analyse des organes cibles
Procédures de nécropsie en fin d’étude
Tous les animaux, y compris ceux du groupe témoin, sont euthanasiés de manière éthique selon les protocoles en vigueur, en minimisant le stress et la souffrance. L’autopsie est réalisée dans les heures qui suivent l’euthanasie, afin de préserver l’intégrité des tissus.
La procédure comprend l’ouverture de la cavité thoracique et abdominale, ainsi que l’examen macroscopique des organes principaux. Les organes sont inspectés visuellement pour détecter des anomalies évidentes : modifications de taille, de couleur, de consistance, présence de lésions, tumeurs, hémorragies ou nécroses.
Un enregistrement précis est effectué pour chaque organe, accompagné de photographies si nécessaire. Les observations sont ensuite mises en relation avec les résultats biologiques, comportementaux et cliniques obtenus pendant l’étude.
Pesée et examen macroscopique des organes
Certains organes sont systématiquement prélevés et pesés afin d’évaluer les variations de masse qui peuvent signaler une hypertrophie, une atrophie ou une inflammation. Cette pesée est effectuée avec des balances de précision après excision, et les organes sont manipulés avec précaution pour éviter toute perte de substance.
Parmi les organes pesés figurent notamment le foie, les reins, les testicules, les épididymes, les ovaires, la rate, le cœur, le thymus, les glandes surrénales et la thyroïde. Le poids absolu et le poids relatif (par rapport au poids corporel) sont calculés pour chaque individu.
Ces mesures constituent des indicateurs sensibles d’un déséquilibre physiologique. Par exemple, une augmentation significative du poids hépatique peut indiquer une induction enzymatique ou une surcharge toxique, tandis qu’une réduction du poids testiculaire peut traduire une atteinte de la spermatogenèse.
Examen histopathologique : lésions, accumulation, effets dose-réponse
Les organes prélevés sont fixés dans une solution de formol tamponné, inclus en paraffine, sectionnés en fines tranches et colorés selon des techniques standard (généralement l’hématoxyline-éosine). Ils sont ensuite examinés au microscope optique par un pathologiste expérimenté.
L’objectif de l’examen histopathologique est d’identifier des altérations microscopiques caractéristiques : inflammation, nécrose cellulaire, vacuolisation, dégénérescence, fibrose, hyperplasie ou infiltration cellulaire. Ces observations permettent de confirmer la nature des effets observés, d’en préciser la localisation, et d’évaluer leur gravité.
Lorsque des effets sont détectés, leur fréquence et leur intensité sont comparées entre les différents groupes de traitement. Cela permet de vérifier s’il existe une relation dose-réponse, et si les effets sont réversibles, persistants ou progressifs.
L’histopathologie constitue ainsi une source de données précieuse pour identifier les organes cibles de la toxicité et orienter les investigations futures. Elle contribue également à l’interprétation des mécanismes d’action de la substance testée, notamment lorsqu’une atteinte spécifique est observée de manière reproductible dans plusieurs études.
Traitement des données et analyse statistique
Outils statistiques utilisés
Les données recueillies au cours de l’étude sont soumises à une série d’analyses statistiques pour détecter d’éventuelles différences significatives entre les groupes exposés à la substance testée et le groupe témoin. Selon la nature des données (paramétriques ou non paramétriques), différents tests peuvent être appliqués.
L’analyse de la variance (ANOVA) est couramment utilisée pour comparer les moyennes entre plusieurs groupes lorsque les données sont normalement distribuées. En cas de différences significatives, des tests post-hoc (comme le test de Dunnett ou de Tukey) permettent d’identifier les groupes concernés. Pour les données non paramétriques, les tests de Kruskal-Wallis ou de Mann-Whitney sont préférés.
Des analyses de régression peuvent également être utilisées pour évaluer la linéarité de la relation dose-effet, tandis que le test du chi carré est adapté pour comparer des fréquences d’événements discrets (comme la survenue de lésions).
Le choix des méthodes dépend du type de variable mesurée (quantitative, qualitative), de la distribution des données, de la taille des groupes, et de la nécessité ou non de corriger les comparaisons multiples. Toutes les analyses doivent être réalisées avec des logiciels validés (ex. : SAS, R, SPSS), selon des protocoles préétablis.
Interprétation des données par rapport aux groupes témoins
Les résultats des groupes exposés sont systématiquement comparés à ceux du groupe témoin afin de déterminer si les écarts observés sont liés à la substance testée ou à une variabilité biologique normale. Cette comparaison est essentielle pour attribuer avec certitude un effet à l’exposition.
Une attention particulière est portée aux différences statistiquement significatives, mais aussi à leur pertinence biologique. Un effet peut être significatif au plan statistique, mais rester dans les limites des valeurs historiques observées pour l’espèce et la souche utilisées. Inversement, une variation modérée mais constante peut indiquer une tendance toxicologique à surveiller.
Pour renforcer la robustesse des résultats, les données obtenues peuvent être comparées à des bases de référence internes ou externes, qui regroupent les résultats d’essais précédents réalisés dans les mêmes conditions. Ces bases de données permettent d’évaluer la cohérence des effets et de détecter des anomalies isolées.
Détermination du NOAEL et du LOAEL
L’un des objectifs principaux du test OCDE 408 est d’identifier un NOAEL (No Observed Adverse Effect Level), c’est-à-dire la dose la plus élevée ne provoquant aucun effet toxique observable. Ce seuil est fondamental pour les évaluations de risque, car il sert de point de départ pour le calcul de la dose journalière admissible (DJA) ou de la valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP).
Lorsque des effets toxiques sont observés, la plus faible dose à laquelle ces effets apparaissent est désignée comme le LOAEL (Lowest Observed Adverse Effect Level). Ces deux valeurs permettent d’encadrer le niveau de sécurité toxicologique de la substance.
La détermination du NOAEL repose sur une synthèse intégrée de l’ensemble des données : signes cliniques, poids corporel, paramètres biochimiques, lésions histopathologiques. Elle doit tenir compte à la fois des résultats statistiques, de leur importance biologique, et de leur reproductibilité.
En cas d’incertitude ou d’absence d’effet, une valeur provisoire peut être proposée, à condition de bien justifier l’absence d’effets nocifs dans les conditions de l’essai. Cette approche conservatrice est souvent acceptée dans un cadre réglementaire, notamment en cas de test limite à forte dose sans toxicité observée.
Intérêt du test OCDE 408 dans le cadre réglementaire
Enregistrement des substances chimiques
Le test OCDE 408 est requis dans le cadre de nombreux dispositifs réglementaires, en particulier le règlement REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) applicable dans l’Union européenne. Il est demandé pour les substances produites ou importées à des tonnages supérieurs à 100 mg/kg/an, afin de documenter leur toxicité à moyen terme.
Les résultats du test permettent de compléter le dossier toxicologique d’une substance en fournissant des données précises sur les effets systémiques, les organes cibles, la relation dose-effet, ainsi que les seuils NOAEL et LOAEL. Ces informations sont essentielles pour déterminer les classifications de danger (toxicité spécifique pour certains organes cibles, toxicité à doses répétées) et pour évaluer les risques pour la santé humaine en fonction des scénarios d’exposition.
Au-delà de REACH, le test OCDE 408 est également utilisé dans le cadre de la réglementation CLP (Classification, Labelling and Packaging), du règlement biocides (BPR), des procédures d’évaluation des produits phytopharmaceutiques ou des demandes d’autorisation de nouvelles substances au niveau international.
Acceptation par les agences de régulation
La méthode OCDE 408 est largement reconnue à l’échelle internationale. Elle est acceptée par les agences de régulation de tous les pays membres de l’OCDE, mais aussi par d’autres juridictions via des accords de reconnaissance mutuelle des données.
Aux États-Unis, elle correspond à l’étude OCSPP 870.3100 définie par l’Environmental Protection Agency (EPA), dans le cadre des évaluations de sécurité des substances chimiques selon la loi TSCA. Cette équivalence permet aux industriels de générer une seule étude valable dans plusieurs régions du monde, ce qui réduit les coûts et évite les duplications inutiles d’expérimentation animale.
L’acceptabilité internationale de cette méthode repose sur sa standardisation, sa robustesse statistique, et son intégration dans des cadres harmonisés d’évaluation du risque. Elle garantit une lecture homogène des résultats par les autorités compétentes, facilitant l’instruction des dossiers réglementaires.
Complémentarité avec les nouvelles approches (NAM)
Malgré son importance, le test OCDE 408 est de plus en plus associé à des méthodes alternatives regroupées sous le terme de NAM (New Approach Methodologies). Ces approches incluent des essais in vitro, des modèles in silico (QSAR), des simulations toxicocinétiques (PBPK), et des stratégies d’extrapolation comme le read-across.
Le recours à ces outils permet de mieux cibler les essais in vivo et de réduire le nombre d’animaux utilisés, conformément au principe des 3R (Remplacer, Réduire, Raffiner). Dans cette logique, le test OCDE 408 est souvent intégré dans des approches de type IATA (Integrated Approaches to Testing and Assessment), combinant plusieurs sources de données pour évaluer un danger ou un risque.
Ainsi, une modélisation PBPK peut être utilisée pour simuler la distribution de la substance dans l’organisme, orienter la sélection des doses et interpréter les effets observés. De même, une alerte issue d’un modèle QSAR sur une structure chimique donnée peut justifier la réalisation ciblée d’un test OCDE 408 pour valider ou infirmer une hypothèse toxicologique.

Réalisation du test OCDE 408 avec YesWeLab
Un réseau expert pour vos besoins réglementaires
YesWeLab s’appuie sur un réseau de plus de 200 laboratoires partenaires, répartis en France et en Europe, tous sélectionnés pour leur haut niveau de compétence technique et leur conformité aux normes internationales. La majorité de ces laboratoires sont accrédités selon la norme ISO 17025 et reconnus par le COFRAC ou leurs équivalents européens.
Pour le test OCDE 408, YesWeLab collabore exclusivement avec des laboratoires spécialisés en toxicologie réglementaire, disposant d’installations adaptées à l’expérimentation animale, et respectant les exigences de la directive 2010/63/UE sur le bien-être animal. Ces partenaires maîtrisent les lignes directrices de l’OCDE et les bonnes pratiques de laboratoire (BPL/GLP), garantissant une production de données conforme aux exigences des autorités réglementaires.
YesWeLab propose un accompagnement scientifique complet, de la définition du protocole jusqu’à l’interprétation des résultats, en intégrant les contraintes spécifiques à chaque secteur : chimie, cosmétique, biocide, santé animale, etc.
Un accompagnement pour l’industrie chimique, cosmétique et santé animale
La réalisation d’un test OCDE 408 est souvent intégrée dans une stratégie globale d’évaluation toxicologique. YesWeLab intervient à toutes les étapes de cette stratégie, en guidant les industriels dans le choix des études nécessaires et dans la priorisation des tests en fonction des profils de risque, des exigences réglementaires et des données existantes.
Pour les fabricants de substances chimiques, le test OCDE 408 permet de répondre aux obligations du règlement REACH. YesWeLab assure la bonne intégration des résultats dans le dossier d’enregistrement, avec une documentation complète et compatible avec les plateformes réglementaires comme IUCLID ou REACH-IT.
Dans le domaine cosmétique, YesWeLab collabore avec les responsables sécurité et les toxicologues pour documenter les effets potentiels des ingrédients à usage prolongé. L’étude OCDE 408 peut ainsi alimenter le rapport sur la sécurité des produits cosmétiques, notamment lorsqu’il s’agit de nouveaux actifs ou de substances controversées.
En santé animale, le test OCDE 408 s’intègre dans les démarches d’autorisation des additifs pour l’alimentation animale ou des substances vétérinaires, avec une attention particulière portée à la sélection des paramètres pertinents pour les espèces cibles.
Une plateforme digitale pour centraliser vos essais
L’un des points forts de YesWeLab réside dans sa plateforme digitale, conçue pour faciliter la gestion des essais de laboratoire. Les industriels peuvent rechercher leurs analyses, demander un devis, suivre l’acheminement des échantillons, et consulter les résultats directement en ligne.
Cette solution tout-en-un permet de centraliser l’ensemble des prestations analytiques, y compris les études OCDE, dans un espace sécurisé et personnalisable. Elle améliore la traçabilité des données, réduit les délais de traitement, et garantit un pilotage optimal des projets réglementaires.
Chaque client bénéficie d’un interlocuteur dédié, expert en analyse réglementaire, qui l’accompagne tout au long du processus : rédaction du cahier des charges, sélection du laboratoire, suivi de l’étude, relecture du rapport et interprétation des résultats. Cette approche sur mesure permet de répondre aux enjeux techniques, réglementaires et stratégiques des entreprises innovantes.