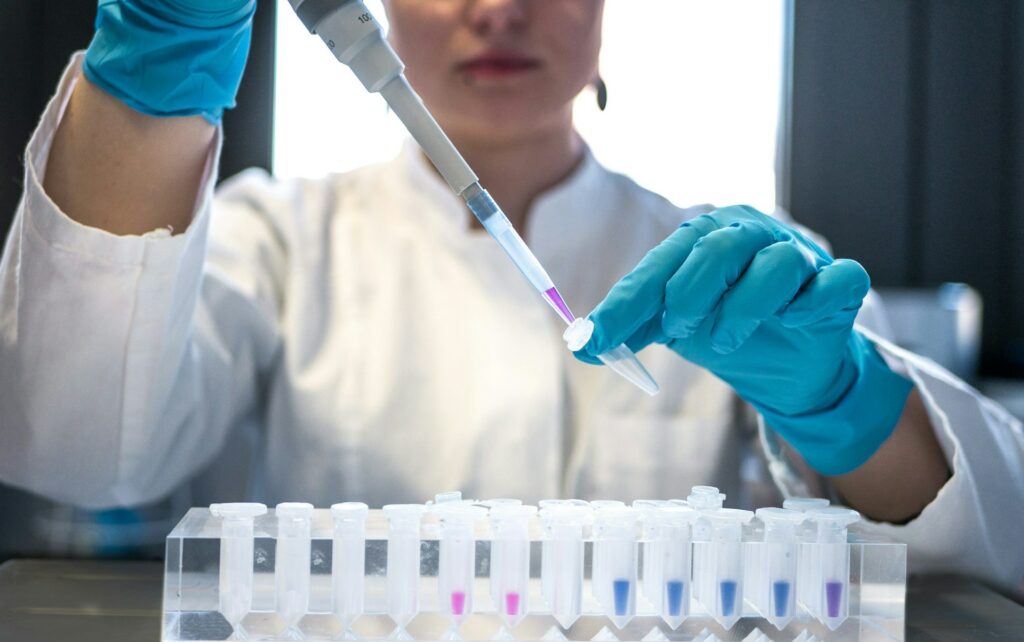La prueba OECD 110 es un método de referencia utilizado en la regulación química. Permite analizar la distribución del tamaño de partículas y fibras en sustancias insolubles en agua. Esta prueba, aunque no es muy conocida, desempeña un papel fundamental en la caracterización fisicoquímica de materiales, especialmente aquellos utilizados en la industria química, materiales compuestos, cosméticos y envases. Adoptada hace varias décadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la prueba OECD 110 proporciona datos cruciales para la evaluación de riesgos, la clasificación reglamentaria y la optimización de formulaciones industriales. Para obtener más información sobre las normas de la OCDE, consulte nuestro artículo dedicado a las Directrices de la OCDE: un pilar de la seguridad química y el análisis de laboratorio.
Tabla de contenido
Contexto y desafíos del análisis del tamaño de partículas
El tamaño, la forma y la distribución de las partículas sólidas son parámetros fundamentales en el estudio de las propiedades fisicoquímicas de una sustancia. Estas características influyen en la solubilidad, dispersión, reactividad, biodisponibilidad y toxicidad de un compuesto. Cuando una sustancia es insoluble en agua, su comportamiento en el medio ambiente y su impacto en los organismos vivos están determinados por el tamaño y la morfología de sus partículas.
En un entorno normativo cada vez más estricto, los fabricantes deben proporcionar datos fiables sobre el tamaño de las partículas presentes en sus productos. El ensayo OECD 110 cumple este requisito. Ofrece dos métodos complementarios según la naturaleza del material analizado: un método para partículas (fibrosas o no fibrosas) y un método específico para materiales que probablemente se presenten en forma de fibras.
Por ello, realizar un análisis del tamaño de las partículas es un paso esencial para caracterizar con precisión estas propiedades.
Una herramienta de establecimiento de estándares reconocida internacionalmente
La prueba 110 de la OCDE es una de las directrices oficiales publicadas por la OCDE para la evaluación de sustancias químicas. Estas directrices son ampliamente reconocidas por las autoridades reguladoras de todo el mundo, especialmente en el marco del reglamento REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas) en Europa, y en los procedimientos de registro en Estados Unidos, Japón y Canadá.
La prueba OECD 110 es una referencia para medir la distribución del tamaño de partículas y caracterizar fibras. Se utiliza en las fases iniciales de numerosos estudios toxicológicos y ecotoxicológicos y constituye una base esencial para cualquier evaluación de riesgos químicos o ambientales.
¿Qué es la prueba OECD 110?
Una directriz derivada del trabajo de la OCDE.
La prueba 110 de la OCDE, titulada oficialmente « Distribución del tamaño de partículas / Distribución de la longitud y el diámetro de las fibras», pertenece a la Sección 1 de las Directrices de la OCDE sobre las propiedades fisicoquímicas de las sustancias. Adoptada en mayo de 1981, sigue vigente y se aplica ampliamente en diversos sectores industriales, siempre que existan requisitos para la caracterización de materias primas o productos terminados.
Esta guía se utiliza en las presentaciones reglamentarias, en particular para el cumplimiento de los requisitos del Reglamento REACH, el Reglamento CLP (Clasificación, Etiquetado y Envasado de Sustancias y Mezclas) y las recomendaciones de la OCSPP (Oficina de Seguridad Química y Prevención de la Contaminación) de Estados Unidos. Asimismo, se incorpora a la normativa internacional sobre el transporte de mercancías peligrosas y a determinados protocolos para la caracterización de nanomateriales.
Objetivo principal de la prueba OECD 110
El objetivo de este ensayo es determinar cuantitativamente la distribución del tamaño de partículas o fibras en una muestra sólida, bajo condiciones controladas y reproducibles. Esta información es esencial para predecir el comportamiento de la sustancia en diferentes entornos (aire, agua, organismos vivos) y para evaluar los riesgos potenciales para la salud humana o el medio ambiente.
Dependiendo de la morfología del material que se esté analizando, se prevén dos métodos:
- El método A se aplica a sustancias en forma de partículas, ya sean esféricas, irregulares o incluso fibrosas.
- El método B está diseñado específicamente para materiales fibrosos, es decir, materiales capaces de formar filamentos alargados con una alta relación longitud/diámetro.
Cada método se basa en principios analíticos diferentes, utilizando herramientas específicas (microscopía óptica o electrónica, sedimentación, centrifugación, etc.), pero persigue el mismo objetivo: establecer una caracterización dimensional completa y científicamente sólida de la sustancia estudiada.
¿Estas buscando un análisis?

¿A qué sustancias se aplica la prueba OECD 110?
Sustancias insolubles en agua
La prueba OECD 110 se aplica exclusivamente a sustancias con una solubilidad en agua inferior a 10⁻⁶ g/L. Esto significa que el material analizado no se disuelve significativamente en agua, ni siquiera a concentraciones muy bajas. Esta característica fisicoquímica tiene implicaciones directas para el comportamiento ambiental y toxicológico de la sustancia, en particular en lo que respecta a su persistencia, dispersión e interacción con los organismos vivos.
Para sustancias solubles, serían más apropiadas otras pruebas de la OCDE, como las relativas al coeficiente de reparto octanol/agua (OCDE 117 u OCDE 123), el pH o la disociación. Sin embargo, para materiales sólidos inertes, en polvo o poco dispersables en agua, la prueba OCDE 110 es una referencia esencial.
Ejemplos de materiales relacionados
Muchos tipos de sustancias industriales pueden incluirse en las pruebas OECD 110. Algunas de las más comunes son:
- Polvos metálicos utilizados en la industria de aleaciones, pigmentos o tintas técnicas.
- Óxidos minerales como el dióxido de titanio de zinc o la sílice, que se encuentran a menudo en pinturas, cosméticos o plásticos.
- Fibras minerales ( lana de roca, fibras de vidrio, aluminosilicatos), utilizadas en materiales aislantes o filtros industriales.
- Algunos nanomateriales o partículas submicrónicas se incorporan en formulaciones avanzadas, como recubrimientos autolimpiantes o aditivos técnicos.
- Productos intermedios de la química fina o la química verde, destinados a ser encapsulados o mezclados en matrices poliméricas.
Un paso preliminar hacia evaluaciones posteriores
La determinación de la distribución del tamaño de las partículas suele ser un paso preliminar en un programa de evaluación toxicológica o ecotoxicológica. Permite, entre otras cosas, adaptar las condiciones de exposición durante ensayos in vitro o in vivo, predecir el comportamiento aerodinámico tras la inhalación y evaluar la posibilidad de paso transmembrana en ciertos organismos. Por ejemplo, en el caso de partículas finas presentes en un aditivo alimentario, este análisis permite evaluar su capacidad para atravesar la barrera intestinal.

¿A qué sustancias se aplica la prueba OECD 110?
Sustancias insolubles en agua
Como se mencionó anteriormente, las pruebas OECD 110 se aplican únicamente a sustancias con una solubilidad en agua inferior a 10⁻⁶ g/L. Esto significa que el material analizado no se disuelve significativamente en agua, incluso a concentraciones muy bajas. Esta característica fisicoquímica tiene implicaciones directas para el comportamiento ambiental y toxicológico de la sustancia, en particular en lo que respecta a su persistencia, dispersión e interacción con los organismos vivos. Por ejemplo, el dióxido de titanio en polvo utilizado en cosméticos permanece en forma de partículas en el medio acuático, lo que exige una evaluación específica de su impacto en los organismos acuáticos.
Para sustancias solubles, serían más apropiadas otras pruebas de la OCDE, como las relativas al coeficiente de reparto octanol/agua (OCDE 117 u OCDE 123), el pH o la disociación. Sin embargo, para materiales sólidos inertes, en polvo o poco dispersables en agua, la prueba OCDE 110 es una referencia esencial.
Ejemplos de materiales relacionados
Muchos tipos de sustancias industriales pueden incluirse en las pruebas OECD 110. Algunas de las más comunes son:
- Polvos metálicos utilizados en la industria de aleaciones, pigmentos o tintas técnicas.
- Óxidos minerales como el dióxido de titanio, el óxido de zinc o la sílice, que se encuentran a menudo en pinturas, cosméticos o plásticos.
- Fibras minerales ( lana de roca, fibras de vidrio, aluminosilicatos), utilizadas en materiales aislantes o filtros industriales.
- Algunos nanomateriales o partículas submicrónicas se incorporan en formulaciones avanzadas, como recubrimientos autolimpiantes o aditivos técnicos.
- Productos intermedios de la química fina o la química verde, destinados a ser encapsulados o mezclados en matrices poliméricas.
Un paso preliminar hacia evaluaciones posteriores
La determinación de la distribución del tamaño de las partículas suele ser un paso preliminar en un programa de evaluación toxicológica o ecotoxicológica. Permite, entre otras cosas, adaptar las condiciones de exposición durante ensayos in vitro o in vivo, anticipar el comportamiento aerodinámico en caso de inhalación o evaluar la posibilidad de paso transmembrana en ciertos organismos.
Método A: Distribución del tamaño de las partículas
Principio general del método
El método A se basa en la caracterización del radio hidrodinámico efectivo (Rs) de las partículas. Este parámetro corresponde al tamaño aparente de una partícula al moverse a través de un fluido y está influenciado por la densidad, la forma y la superficie de la partícula. El método es aplicable a partículas con un Rs entre 2 µm y 100 µm . Por debajo o por encima de este rango, no se garantiza la precisión de la medición.
El análisis comienza con la observación microscópica de la muestra bajo luz visible . Este paso permite verificar la naturaleza de las partículas y eliminar cualquier impureza, agregado o aglomeración. A continuación, se aplican técnicas estandarizadas para evaluar la distribución del tamaño según tres clases principales:
- Partículas de tamaño superior a 200 µm.
- Partículas de entre 2 y 200 µm.
- Partículas menores de 2 µm.
Estos tres intervalos permiten una evaluación suficientemente precisa del tamaño de las partículas para una amplia gama de productos industriales.
Técnicas analíticas utilizadas
Para determinar el tamaño de partícula según el método A, se pueden utilizar diversos enfoques, dependiendo de las propiedades físicas de la muestra. Las técnicas más comunes son:
- Sedimentación : este método se basa en la velocidad de sedimentación de las partículas en un líquido. Es adecuado para sustancias densas y poco dispersables.
- Centrifugación : acelera el proceso de sedimentación aplicando una fuerza centrífuga, lo que mejora la precisión y permite trabajar con volúmenes más pequeños.
- El contador Coulter : este instrumento mide los cambios en la conductividad causados por el paso de partículas a través de una abertura calibrada. Es particularmente útil para suspensiones acuosas o electrolíticas.
Cada técnica debe seleccionarse cuidadosamente según la naturaleza química y física de la sustancia, la forma de las partículas y las condiciones experimentales. Es fundamental asegurar una correcta dispersión de la muestra antes del análisis para evitar errores de medición relacionados con la agregación.
Aplicaciones del método A
El método A se utiliza ampliamente en evaluaciones regulatorias, control de calidad y proyectos de formulación. Por ejemplo, permite:
- Compruebe la distribución del tamaño de partícula de un pigmento o aditivo antes de incorporarlo a una matriz plástica o cosmética.
- Evaluar la estabilidad de un producto en forma de polvo o suspensión.
- Identificar los riesgos asociados a la inhalación de partículas finas en un contexto profesional.
Gracias a su flexibilidad y a la variedad de técnicas que se pueden utilizar, el método A constituye una herramienta analítica fiable y versátil para la caracterización dimensional de partículas sólidas.
Método B: Distribución de la longitud y el diámetro de la fibra
¿Cuándo aplicar el método B?
El método B se aplica exclusivamente a sustancias fibrosas, es decir, materiales cuyas unidades constituyentes pueden adoptar una forma filamentosa. Estas fibras se caracterizan por una elevada relación longitud/diámetro , lo que implica un comportamiento aerodinámico y toxicológico específico. Este tipo de morfología se encuentra frecuentemente en:
- Fibras minerales artificiales ( lana de roca, fibras de vidrio).
- Fibras cerámicas refractarias .
- Algunos nanomateriales alargados o compuestos fibrosos .
El valor de este método radica en la necesidad de evaluar mejor la toxicidad potencial de las fibras en caso de exposición por inhalación. Las fibras largas, delgadas, insolubles y biopersistentes pueden suponer un riesgo para el sistema respiratorio, como han demostrado estudios sobre fibras de amianto. Por ello, los organismos reguladores exigen una caracterización precisa de estos parámetros antes de que cualquier producto se comercialice o se integre en procesos industriales.
Parámetros medidos y umbrales definidos
El método B se basa en la medición de dos parámetros morfológicos esenciales:
- La longitud (l) de las fibras, que debe ser mayor o igual a 5 µm .
- El diámetro (d) , que debe ser mayor o igual a 0,1 µm .
Estos umbrales se establecen para excluir fragmentos demasiado cortos o delgados, que resultan irrelevantes para el análisis toxicológico. La medición se realiza mediante un microscopio electrónico de barrido (MEB) o un microscopio electrónico de transmisión (MET), según el tipo de fibra y la precisión requerida.
al menos fibras distintas dos histogramas :
- Un histograma de la distribución de longitudes.
- Histograma de la distribución del diámetro.
Estos gráficos permiten identificar las clases mayoritarias, observar la homogeneidad de la muestra y detectar cualquier anomalía o subpoblación de fibras.
Limitaciones técnicas y mejores prácticas
El método B requiere un alto nivel de especialización técnica. La preparación de la muestra debe evitar cualquier alteración de las fibras o la creación de artefactos. El análisis debe realizarse en un entorno limpio, con equipos calibrados y trazabilidad completa. Los laboratorios que realizan este tipo de análisis suelen contar con personal especializado en microscopía analítica y metrología dimensional.
El uso del método B es infrecuente pero esencial en ciertos casos regulatorios, particularmente al registrar nuevas fibras industriales o reevaluar sustancias existentes. Desempeña un papel fundamental en la prevención de riesgos laborales y en el cumplimiento de las directivas europeas sobre sustancias peligrosas.
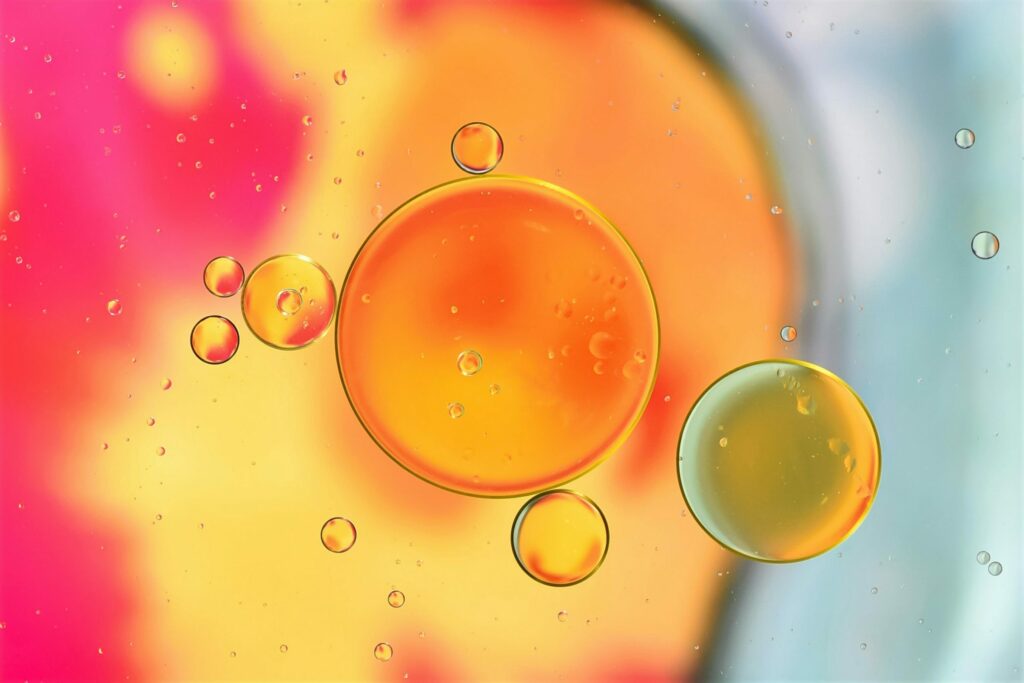
¿Por qué es importante la prueba OECD 110?
Una herramienta de apoyo a la toma de decisiones regulatorias
Los resultados obtenidos con la prueba OECD 110 se utilizan en numerosos expedientes regulatorios. En particular, permiten:
- Demostrar la conformidad de las sustancias según el reglamento REACH , que exige la caracterización completa de las sustancias producidas o importadas en cantidades superiores a una tonelada al año.
- Contribuir a la clasificación de un producto según el reglamento CLP (Clasificación, Etiquetado y Envasado) , particularmente en caso de riesgo de inhalación de partículas finas o fibras.
- Cumplir con los requisitos de las autoridades de salud y protección ambiental, como la ECHA en Europa, la EPA en Estados Unidos o las autoridades canadienses y japonesas .
Estos datos también pueden integrarse en sistemas de modelización de riesgos (exposición, transporte, deposición pulmonar) y en informes presentados a través de la IUCLID , una herramienta central para el registro reglamentario de sustancias químicas.
Una influencia directa sobre la toxicidad y la exposición
El tamaño y la forma de las partículas influyen directamente en el comportamiento toxicológico de una sustancia. Por ejemplo:
- Las partículas pequeñas (menores de 10 µm) pueden llegar a los alvéolos pulmonares y quedar atrapadas allí.
- Las fibras largas, delgadas y biopersistentes pueden causar reacciones inflamatorias crónicas o patologías respiratorias graves, como ocurre con algunas fibras cerámicas.
- Una distribución de tamaño heterogénea o bimodal puede indicar inestabilidad del producto o una dispersión deficiente, lo que aumenta el riesgo de exposición accidental.
Por ello, el conocimiento preciso de la distribución del tamaño es un requisito esencial para interpretar los resultados de las pruebas toxicológicas, elegir los métodos de exposición adecuados (inhalación, ingestión, contacto con la piel) y establecer medidas de prevención apropiadas .
Un vínculo con otros ensayos de la OCDE
La prueba OECD 110 puede utilizarse junto con otras pruebas fisicoquímicas, incluidas:
- La norma OECD 109 sobre la densidad de líquidos y sólidos es útil para modelar la sedimentación.
- OECD 114 sobre viscosidad, relevante para suspensiones que contienen partículas.
- La norma OECD 125 , específica para nanomateriales, también analiza la distribución del tamaño de las partículas con técnicas más sensibles.
- OECD 124 sobre superficie específica por volumen, que puede correlacionarse con el tamaño de partícula medido mediante la prueba OECD 110.
La integración de estos datos en un expediente de evaluación integral permite una mejor predicción del comportamiento ambiental y un perfeccionamiento de los escenarios de exposición , en particular para las sustancias clasificadas como peligrosas o sujetas a restricciones.
Realice la prueba OECD 110 con YesWeLab: una solución integral
Una red de laboratorios acreditados
YesWeLab cuenta con una red de más de 200 laboratorios asociados ubicados en toda Francia y Europa. Estos laboratorios son seleccionados por su alto nivel de especialización técnica y su capacidad para cumplir con los requisitos reglamentarios más exigentes. Según sus necesidades, se pueden realizar las pruebas OECD 110.
- Bajo la acreditación ISO 17025 , para garantizar la fiabilidad de los métodos y la validación de los resultados.
- Bajo condiciones de BPL (Buenas Prácticas de Laboratorio) , para garantizar el reconocimiento reglamentario de los datos, en particular en los expedientes REACH, OCSPP o de la ONU.
Los laboratorios asociados también cumplen con las normas regulatorias internacionales, tales como:
- Reglamento (CE) n.º 440/2008 sobre métodos de ensayo aplicables a REACH.
- El Reglamento CLP (CE n.º 1272/2008) relativo a la clasificación y el etiquetado de sustancias.
- Directrices de la OCDE y normas OCSPP (Estados Unidos).
Una plataforma digital para simplificar sus procedimientos
YesWeLab ha desarrollado una plataforma digital única , diseñada para profesionales del sector, que centraliza todos los procesos analíticos. Esta plataforma permite a los usuarios:
- Busque rápidamente un análisis en un catálogo de más de 10.000 servicios.
- Obtenga un presupuesto en tan solo unos clics , con o sin requisitos de Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL).
- Realice el seguimiento del envío y la recepción de muestras en tiempo real..
- de forma segura a los resultados e informes validados
Este funcionamiento fluido reduce los tiempos de procesamiento, disminuye los errores administrativos y ofrece una trazabilidad completa de las pruebas, desde el pedido hasta la validación del informe final.
Soporte experto y personalizado
Además de los servicios técnicos, YesWeLab ofrece soporte personalizado a cada cliente. Un experto dedicado le ayudará a:
- Elija el método correcto (A o B) según la naturaleza de su sustancia.
- Determinar las condiciones óptimas de análisis , teniendo en cuenta las restricciones reglamentarias y las propiedades del material.
- Validar que el informe cumple con los requisitos de la IUCLID o con las normas internacionales.
- Anticipe necesidades adicionales , como pruebas toxicológicas o análisis multimétodo (OCDE 109, 114, 125).
YesWeLab actúa así como socio estratégico en su proceso de cumplimiento, ofreciéndole un fácil acceso a pruebas de alta calidad, al tiempo que garantiza la capacidad de respuesta y la transparencia del servicio.