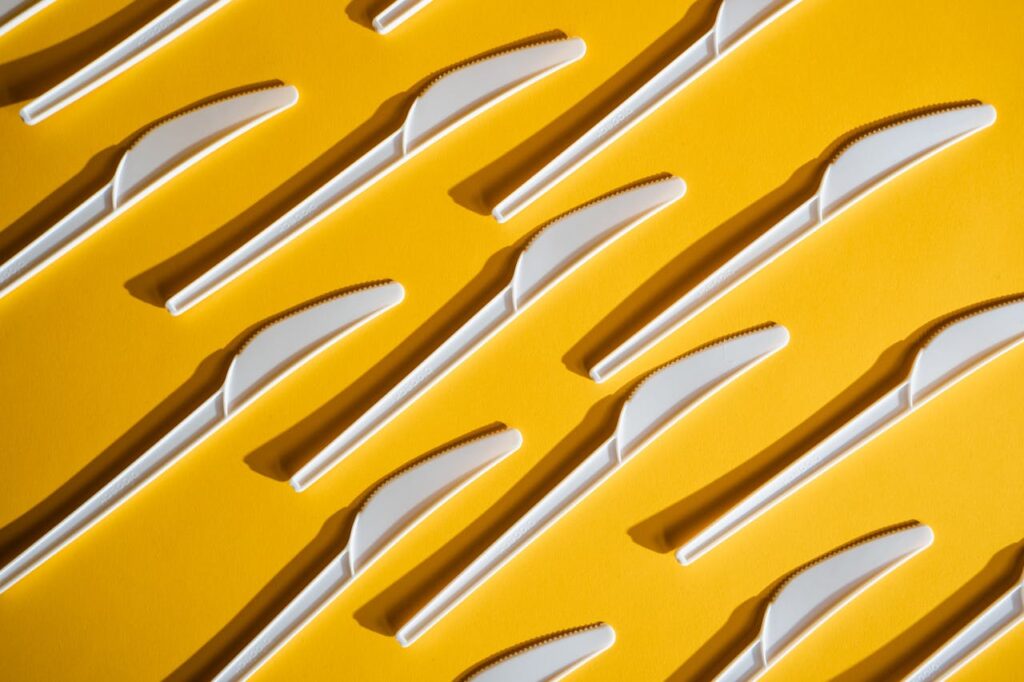DSC (calorimétrie différentielle à balayage) est une méthode d’analyse thermique incontournable pour évaluer la réponse d’un matériau à une variation de température. Dans un contexte industriel où la maîtrise des matériaux est devenue stratégique, comprendre leur comportement thermique est essentiel. Que ce soit pour contrôler la qualité d’un polymère, valider la stabilité d’une protéine ou optimiser la mise en forme d’un matériau composite, les ingénieurs, formulateurs et responsables qualité s’appuient sur des outils d’analyse avancés. Découvrez les analyses disponibles en DSC dans notre catalogue pour mieux répondre à vos besoins.
Cet article vous guide pas à pas dans les principes, les applications et les enjeux liés à cette technique de référence.
Table des matières
Introduction à la DSC : pourquoi analyser le comportement thermique des matériaux ?
La maîtrise thermique, un enjeu clé pour l’industrie
Dans tous les secteurs techniques – plasturgie, pharmaceutique, cosmétique, agroalimentaire ou matériaux avancés – les produits subissent des variations de température, que ce soit lors de leur fabrication, leur conditionnement, leur transport ou leur utilisation finale. Ces variations peuvent entraîner des transformations physiques ou chimiques majeures : fusion, réticulation, dégradation, cristallisation, ou encore perte de stabilité. Sans une connaissance fine de ces comportements, les industriels s’exposent à des risques de non-conformité, de baisse de performance ou de défauts produit.
L’analyse thermique permet donc d’anticiper ces réactions et d’optimiser les formulations, les procédés et les conditions d’utilisation. Dans ce domaine, la DSC fait figure d’incontournable.
Une technique au cœur du contrôle qualité et de la R&D
La calorimétrie différentielle à balayage, plus connue sous son acronyme DSC (Differential Scanning Calorimetry), permet d’évaluer comment un matériau réagit à un programme thermique contrôlé. Elle s’appuie sur la mesure précise des flux de chaleur impliqués dans les transitions de phase ou les réactions chimiques du matériau analysé.
Grâce à cette approche, la DSC permet de :
- déterminer les températures caractéristiques d’un matériau (fusion, cristallisation, transition vitreuse) ;
- mesurer les quantités d’énergie absorbées ou dégagées (enthalpie) ;
- évaluer la stabilité thermique d’un produit ;
- vérifier l’efficacité d’un traitement thermique (réticulation, durcissement, cuisson) ;
- caractériser la nature et la pureté d’un matériau.
C’est donc une méthode précieuse pour les services de contrôle qualité, les bureaux d’études matériaux, ou les équipes de R&D qui développent de nouveaux produits.
Une technologie accessible, rapide et polyvalente
La DSC présente de nombreux atouts qui expliquent sa popularité en laboratoire :
- elle est applicable à une grande diversité de matériaux : polymères, composites, métaux, céramiques, produits pharmaceutiques, cosmétiques, aliments, protéines… ;
- elle nécessite une faible quantité d’échantillon (quelques milligrammes) ;
- elle offre des résultats précis et reproductibles, même sur des transitions thermiques faibles ou complexes ;
- elle permet des mesures rapides, avec des cycles typiques de quelques dizaines de minutes.
Enfin, les équipements modernes proposent des options avancées, comme la modulation de température (MDSC), qui permet de séparer les événements thermiques se chevauchant, ou les mesures directes de capacité thermique.
Une méthode soutenue par des normes internationales
Comme toute analyse en laboratoire à visée industrielle, la DSC s’inscrit dans un cadre normatif strict. Les laboratoires qui réalisent des analyses DSC doivent être accrédités selon la norme ISO 17025 pour garantir la fiabilité et la validité des résultats. En France, cette accréditation est délivrée par le COFRAC.
L’analyse DSC peut aussi être exigée dans certains cahiers des charges ou référentiels réglementaires, notamment dans les secteurs des emballages en contact alimentaire ou des matériaux polymères destinés à l’exportation. Elle constitue donc à la fois un outil de caractérisation, un outil de diagnostic et une exigence de conformité.

Qu’est-ce que la calorimétrie différentielle à balayage (DSC) ?
La calorimétrie différentielle à balayage, ou DSC (differential scanning calorimetry), est une technique d’analyse thermique qui repose sur la mesure des échanges de chaleur entre un échantillon à analyser et une référence inerte. Lorsqu’un matériau est soumis à une variation de température, il peut absorber ou libérer de l’énergie en fonction de la nature des transformations physiques ou chimiques qu’il subit. C’est cette différence de flux de chaleur que la DSC permet de mesurer avec précision.
Définition scientifique de la DSC
La DSC est une méthode instrumentale utilisée pour mesurer la quantité d’énergie (en joules) qu’un échantillon absorbe ou dégage au fur et à mesure qu’il est chauffé, refroidi ou maintenu à température constante. Elle permet de détecter des événements thermiques comme :
- des transitions de phase physiques (fusion, cristallisation, transition vitreuse) ;
- des réactions chimiques (réticulation, polymérisation, dégradation…) ;
- des changements de structure (relaxation, séparation de phase…).
Les mesures sont effectuées en comparant le comportement thermique de l’échantillon à celui d’une référence thermiquement neutre, placée dans un creuset identique. La température est augmentée de manière linéaire (typiquement entre 0,1 et 20 °C/min), et la différence de flux de chaleur est enregistrée en fonction de la température ou du temps.
Principe de fonctionnement de la DSC
Le principe fondamental de la DSC repose sur le fait que lors d’un changement d’état, l’échantillon échange de l’énergie avec son environnement pour compenser les besoins thermiques liés à la transition. Cette énergie se traduit par une variation du flux de chaleur mesuré par l’appareil.
Deux grands types de transitions peuvent être observés :
- les processus endothermiques, comme la fusion ou la transition vitreuse, où l’échantillon absorbe de la chaleur pour maintenir sa température constante pendant le changement d’état ;
- les processus exothermiques, comme la cristallisation ou la réticulation, où l’échantillon dégage de la chaleur.
Ces phénomènes sont visibles sur le thermogramme DSC sous forme de pics (vers le haut pour les événements exothermiques, vers le bas pour les événements endothermiques dans la majorité des systèmes). Le pic est caractérisé par :
- sa température de début, de pic et de fin ;
- sa surface, qui correspond à l’enthalpie associée à la transition.
Méthodes de mesure : flux de chaleur et puissance compensée
Il existe deux types principaux de dispositifs DSC, qui diffèrent par leur mode de détection thermique :
- DSC à flux de chaleur (heat-flux DSC)
C’est la méthode la plus répandue. L’échantillon et la référence sont placés dans un même four, sur un support commun qui assure la conduction thermique. Le système mesure la différence de température entre les deux creusets pour en déduire le flux thermique. - DSC à puissance compensée (power-compensated DSC)
Ici, l’échantillon et la référence sont logés dans deux fours distincts mais thermiquement couplés. Chaque four est chauffé de manière indépendante, et l’appareil ajuste en permanence la puissance fournie à chaque creuset pour maintenir les deux à la même température. La différence de puissance appliquée est directement liée au flux de chaleur de l’échantillon.
Les DSC modernes permettent également des analyses modulées (MDSC) où une modulation sinusoïdale de température est superposée au programme thermique. Cette technique permet de séparer les phénomènes réversibles (transitions de phase) et irréversibles (réactions chimiques), ce qui améliore la résolution dans le cas d’événements thermiques se chevauchant.
Interprétation d’un thermogramme DSC
Le thermogramme est le graphique central de l’analyse DSC. Il représente la différence de flux thermique (en mW ou mW/mg) en fonction de la température ou du temps.
Voici quelques éléments clés à identifier sur un thermogramme :
- Pic endothermique large et progressif : transition vitreuse (Tg), sans changement d’enthalpie notable.
- Pic endothermique net et symétrique : fusion (Tm), associé à une absorption de chaleur importante.
- Pic exothermique : cristallisation, polymérisation, ou oxydation.
L’analyse de la surface du pic permet de calculer l’enthalpie de transition (ΔH), exprimée en J/g. Cette donnée est essentielle pour évaluer :
- le taux de cristallinité (dans un polymère semi-cristallin) ;
- le degré de réticulation (dans un matériau thermodurcissable) ;
- ou encore la pureté d’un composé, notamment dans le domaine pharmaceutique.
La capacité à détecter des transitions thermiques faibles, comme une séparation de phase dans un copolymère ou une dénaturation partielle d’une protéine, fait aussi de la DSC un outil de diagnostic très fin.
Calibration et conditions expérimentales
Pour garantir des résultats fiables et reproductibles, la DSC nécessite une calibration régulière, notamment sur :
- la température, avec des matériaux de référence bien connus comme l’indium (Tf = 156,6 °C, ΔH = 28,45 J/g) ou le zinc ;
- le flux de chaleur, en utilisant des standards certifiés.
Les analyses doivent être réalisées sous gaz inerte (argon ou azote) pour éviter toute oxydation ou réaction indésirable, et avec des échantillons préparés soigneusement (masse, forme, absence d’humidité). Le choix du creuset (alu, hermétique, ouvert) dépend de la nature du matériau étudié et du type d’analyse recherchée.
Dans les parties suivantes, nous explorerons les paramètres mesurés par la DSC ainsi que ses nombreuses applications industrielles.
Vous recherchez une analyse ?

Quels paramètres peut-on mesurer avec une analyse DSC ?
L’analyse DSC fournit une multitude d’informations thermodynamiques et structurales sur un matériau. Ces données sont précieuses pour comprendre son comportement en cours de transformation, anticiper sa stabilité ou valider ses propriétés fonctionnelles. Les résultats s’appuient sur des mesures directes des échanges de chaleur liés à des phénomènes physiques ou chimiques qui se produisent à des températures spécifiques. Voici les principaux paramètres mesurés lors d’une analyse DSC.
Température de transition vitreuse (Tg)
La transition vitreuse (notée Tg) est une caractéristique fondamentale des matériaux amorphes, notamment des polymères, verres, résines ou biopolymères. Elle correspond au passage d’un état rigide à un état plus souple ou caoutchouteux sans changement d’état physique.
La température de transition vitreuse est mesurée sous forme d’un palier ou d’une inflexion sur le thermogramme, généralement sur un pic très large. Cette transition n’est pas accompagnée d’un échange massif de chaleur, mais elle est détectable par une variation de la capacité thermique (Cp).
Mesurer la Tg permet de :
- déterminer les conditions d’usage d’un matériau (résistance mécanique à température ambiante ou élevée) ;
- suivre l’évolution d’un produit au cours du temps ou après traitement ;
- contrôler la stabilité d’un polymère ou d’un composite après vieillissement ou stérilisation.
Température de fusion (Tm) et de cristallisation (Tc)
La température de fusion (Tm) correspond à la transformation d’un solide cristallin en liquide. Cette transition est endothermique et se manifeste sur le thermogramme par un pic descendant net. La surface de ce pic permet de calculer l’enthalpie de fusion (ΔHf).
Inversement, la température de cristallisation (Tc) correspond à la formation d’une phase solide organisée à partir d’un liquide ou d’un matériau amorphe. Cette transition est exothermique, visible par un pic ascendant sur le thermogramme.
Ces données sont essentielles pour :
- optimiser les paramètres de transformation thermique (température de moulage, d’injection, de recuit…) ;
- quantifier le taux de cristallinité (en comparant l’enthalpie mesurée avec celle d’un matériau 100 % cristallin) ;
- analyser le comportement de refroidissement ou de recuisson d’un polymère, métal ou composite.
Enthalpie de réaction et taux de réticulation
Certains matériaux, notamment les résines thermodurcissables ou les composites à matrice organique, subissent une réticulation (ou durcissement) lors d’une montée en température. Cette réaction chimique est souvent exothermique, et génère un pic sur le thermogramme dont la surface correspond à l’enthalpie de réaction.
Cette mesure permet de :
- quantifier le taux de réticulation d’une résine (en comparant l’énergie dégagée à la valeur théorique) ;
- identifier une cure incomplète ou un défaut de cuisson ;
- caractériser le cycle thermique subi par une pièce en composite.
En formulation, l’enthalpie de réaction est aussi utile pour ajuster les proportions de durcisseurs, les temps de cuisson ou les températures de traitement.
Capacité thermique (Cp)
La capacité thermique (ou capacité calorifique), exprimée en J/g·K, désigne la quantité de chaleur nécessaire pour élever la température d’un gramme de matériau d’un degré. Dans certains modèles de DSC avancés, elle peut être mesurée directement à partir du flux thermique absolu divisé par la vitesse de chauffage.
Le suivi de la Cp en fonction de la température permet d’observer des changements progressifs dans la structure ou la composition du matériau. C’est un paramètre particulièrement utile pour :
- détecter les transitions de phase progressives ;
- observer des phénomènes de relaxation, vieillissement ou séparation de phase ;
- analyser le comportement thermique de protéines ou de substances complexes.
Taux de cristallinité
Le taux de cristallinité est un indicateur de l’ordre structuré présent dans un matériau semi-cristallin. Il se calcule en comparant l’enthalpie de fusion mesurée (ΔHf mesurée) à l’enthalpie de fusion théorique d’un matériau 100 % cristallin (ΔHf théorique), selon la formule :
Taux de cristallinité (%) = (ΔHf mesurée / ΔHf théorique) × 100
Par exemple, pour le polyéthylène haute densité (PEHD), l’enthalpie de fusion théorique est d’environ 293 J/g.
Connaître ce taux permet de :
- ajuster la structure et les performances mécaniques d’un matériau ;
- évaluer la qualité d’un traitement thermique (recuisson, trempe, refroidissement…) ;
- détecter une dégradation ou une cristallisation partielle.
Pureté et homogénéité d’un matériau
Enfin, la DSC est également utilisée pour estimer la pureté d’un composé (notamment en pharmacie ou en chimie fine), en analysant la forme et la position du pic de fusion :
- un pic net et unique correspond à une pureté élevée ;
- un pic large ou décalé peut indiquer la présence d’impuretés ou de polymorphes.
Cette analyse est précieuse pour :
- valider la qualité d’un principe actif pharmaceutique (API) ;
- identifier un lot contaminé ou mal formulé ;
- détecter la présence de phases secondaires ou de mélanges.

Applications industrielles de la DSC : un outil polyvalent
La DSC n’est pas qu’un outil de laboratoire réservé aux travaux de recherche. C’est une technique d’analyse largement utilisée en industrie pour le contrôle qualité, l’optimisation des procédés et le développement de nouveaux produits. Sa polyvalence en fait un allié stratégique dans de nombreux secteurs. Du polymère technique au vaccin thermostable, chaque matériau peut révéler ses propriétés thermiques et structurelles grâce à une analyse DSC bien conduite.
Secteur des polymères et plastiques
La DSC est une méthode de référence dans l’univers des polymères. Elle permet de caractériser avec précision les propriétés thermiques qui déterminent leur aptitude à la transformation ou à l’usage.
Les usages industriels de la DSC dans ce secteur incluent :
- la détermination de la température de transition vitreuse (Tg) pour choisir les températures d’utilisation ou de stockage ;
- la mesure des températures de fusion (Tm) pour définir les paramètres de moulage ou d’extrusion ;
- l’évaluation du taux de cristallinité, qui influence la résistance mécanique, la transparence ou la rigidité ;
- le contrôle du taux de réticulation des polymères thermodurcissables utilisés dans les colles, résines ou composites.
Exemples d’applications :
- validation matière pour l’injection plastique (PP, PET, PA, POM…) ;
- suivi de lot de PEHD pour des emballages alimentaires ;
- caractérisation d’élastomères pour l’industrie automobile.
Matériaux composites : thermodurcissables et thermoplastiques
Dans les matériaux composites, en particulier ceux à matrice organique, l’analyse DSC joue un rôle essentiel à plusieurs étapes du cycle de vie du produit.
Les principales applications incluent :
- le contrôle de la réticulation des résines thermodurcissables (époxy, polyester, vinylester…) pour valider le cycle de cuisson ou identifier une sous-polymérisation ;
- la détermination de la Tg post-curing, pour s’assurer que le matériau supportera les contraintes mécaniques et thermiques finales ;
- l’évaluation de la cristallinité des matrices thermoplastiques (PEEK, PPS, PEI) utilisées en aéronautique ou en médical.
La DSC est également précieuse en expertise défaillance pour détecter une erreur de cuisson, une mauvaise formulation ou une altération du matériau après vieillissement.
Industrie pharmaceutique et biomoléculaire
Dans le domaine pharmaceutique, la DSC est utilisée à la fois pour les substances actives, les formulations finies et les protéines thérapeutiques.
Les usages courants comprennent :
- la caractérisation de la pureté des principes actifs (pic de fusion net, absence d’impuretés) ;
- la mesure de la stabilité thermique des protéines (température de dénaturation, ΔH associée), essentielle pour les anticorps monoclonaux, les vaccins ou les enzymes ;
- l’étude des interactions ligand-protéine, pour évaluer l’efficacité ou la compatibilité d’un excipient ;
- la vérification des polymorphes ou états cristallins différents d’un même composé, ayant un impact sur la solubilité ou la biodisponibilité.
La DSC est aussi utile dans le contrôle qualité des formulations complexes comme les suspensions, les crèmes ou les dispositifs combinés.
Cosmétiques et formulation
En cosmétique, la texture, la stabilité et la performance d’un produit reposent souvent sur des équilibres thermiques sensibles. La DSC permet ici d’objectiver les propriétés fonctionnelles des formulations.
Parmi les applications principales :
- étude des transitions thermiques dans les émulsions, pour détecter les instabilités ou les risques de séparation de phase ;
- analyse de la stabilité thermique d’un ingrédient actif (vitamines, huiles essentielles, acides de fruits…) ;
- caractérisation des cires, beurres et bases anhydres, par leurs profils de fusion ;
- détection de l’influence d’un additif sur la structure d’un gel ou d’un sérum.
La DSC est également utilisée pour valider les effets d’un traitement thermique (séchage, stérilisation) sur la formulation finale.
Produits agroalimentaires
L’agroalimentaire exploite aussi la DSC pour caractériser des phénomènes physiques comme la fusion, la cristallisation ou la gélification.
Quelques applications typiques :
- détermination du point de fusion de matières grasses (beurres, margarines, huiles végétales) ;
- analyse de la cristallisation des sucres ou amidons, avec influence sur la texture et la conservation ;
- étude des transitions vitreuces dans les poudres (laits infantiles, arômes, ingrédients secs) pour prévoir la stabilité ;
- évaluation de la dénaturation des protéines dans les produits transformés ou enrichis.
Ces données permettent d’optimiser les procédés (lyophilisation, extrusion, cuisson), de contrôler la qualité des ingrédients ou d’améliorer la durée de vie des produits.

Analyses de laboratoire par DSC : protocoles, normes et qualité des résultats
Si la DSC est une méthode puissante et polyvalente, sa fiabilité repose avant tout sur le respect rigoureux des protocoles analytiques, le choix des bons paramètres expérimentaux et l’application des standards de qualité. Cette partie décrit les étapes clés de l’analyse DSC en laboratoire, les exigences normatives à respecter, ainsi que les bonnes pratiques garantissant des résultats exploitables, notamment dans un cadre industriel ou réglementaire.
Préparation de l’échantillon : une étape déterminante
Une analyse DSC commence toujours par la sélection et la préparation de l’échantillon. Ces étapes conditionnent directement la qualité du signal thermique.
Les principaux points de vigilance sont :
- masse de l’échantillon : généralement comprise entre 2 et 20 mg, en fonction de la nature du matériau et de la résolution souhaitée ;
- état physique : l’échantillon doit être homogène, sans humidité résiduelle ni impureté (surtout pour les polymères et protéines) ;
- forme et contact thermique : la poudre ou le fragment doit être bien réparti dans le creuset pour un transfert thermique optimal ;
- type de creuset : aluminium pour la plupart des analyses, hermétique pour les matériaux volatils ou sensibles à l’oxydation, en or ou en platine pour les cas extrêmes.
Un soin particulier doit être apporté à la pesée initiale, réalisée sur une microbalance, car les calculs d’enthalpie et de capacité calorifique dépendent de la masse exacte de l’échantillon.
Conditions expérimentales : programmation thermique et atmosphère
Une fois l’échantillon placé dans le DSC, un programme de température est appliqué. Ce programme est défini selon les propriétés du matériau à analyser et l’objectif de l’étude.
Les paramètres à configurer sont :
- plage de température : typiquement entre -100 °C et +400 °C, jusqu’à +700 °C pour les DSC haute température ;
- vitesse de rampe : souvent entre 2 et 20 °C/min ; des rampes plus lentes sont utilisées pour des transitions subtiles ;
- segments isothermes : parfois insérés avant ou après un palier de transition pour observer des équilibres thermiques ;
- gaz de balayage : généralement azote ou argon (50 à 100 mL/min) pour éviter l’oxydation ou les réactions parasites.
Des essais à température modulée (MDSC) peuvent également être menés pour distinguer des transitions superposées ou pour améliorer la résolution des transitions vitreuses.
Calibration et validation de l’appareil
Pour garantir la justesse des résultats, le calorimètre doit être calibré régulièrement, tant en température qu’en enthalpie.
Les standards de calibration incluent :
- l’indium (Tf = 156,6 °C ; ΔH = 28,45 J/g) ;
- le zinc, l’étain ou le plomb, pour élargir la plage de calibration.
Les laboratoires accrédités ISO 17025 mettent en œuvre des procédures de vérification métrologique régulière, traçables aux étalons nationaux. En complément, des matériaux de contrôle interne (MCI) peuvent être utilisés pour valider chaque série d’analyses.
Normes et conformité : ISO 17025 et secteurs réglementés
L’analyse DSC est encadrée par des normes internationales garantissant la compétence des laboratoires et la validité des résultats :
- ISO 11357 (parties 1 à 7) : norme de référence pour les analyses thermiques sur polymères par DSC ;
- ISO 17025 : norme qualité imposée aux laboratoires pour garantir la fiabilité, la traçabilité et l’impartialité des analyses
Dans certains secteurs, la DSC est également soumise à des référentiels spécifiques :
- emballages alimentaires : conformité au règlement CE n° 1935/2004 sur les matériaux au contact des denrées ;
- cosmétique et nutraceutique : sécurité et stabilité des formulations selon les lignes directrices européennes.
Les rapports d’analyse doivent inclure toutes les données critiques : conditions expérimentales, thermogrammes, interprétation, incertitudes, signature d’un analyste responsable, et mention de l’accréditation le cas échéant.
Interprétation et exploitation des résultats
La dernière étape d’une analyse DSC est l’interprétation du thermogramme. Cette phase exige expertise et recul pour :
- identifier les événements thermiques significatifs : transitions de phase, réactions chimiques, artefacts éventuels ;
- quantifier les paramètres thermodynamiques : températures, enthalpies, capacités thermiques ;
- comparer les profils à ceux de matériaux standards ou à des données antérieures ;
- émettre des conclusions exploitables : conformité, performance, altération, vieillissement…
Un bon laboratoire ne se contente pas de fournir un résultat brut. Il doit accompagner l’industriel dans l’analyse des écarts, la compréhension des causes racines et la prise de décision.

Pourquoi faire appel à YesWeLab pour une analyse DSC ?
La calorimétrie différentielle à balayage (DSC) est une technique d’analyse thermique de haute précision, essentielle pour caractériser les transitions thermiques d’un matériau. Pour exploiter pleinement les résultats et garantir la fiabilité des données, il est crucial de faire appel à un partenaire maîtrisant à la fois les exigences techniques et les enjeux industriels. YesWeLab vous permet d’accéder à des analyses DSC réalisées par des laboratoires spécialisés, via une plateforme digitale simple, rapide et centralisée.
Une expertise technique pointue pour vos matériaux complexes
Les résultats obtenus par DSC sont d’une grande richesse, mais nécessitent une interprétation experte. Les laboratoires YesWeLab disposent :
- d’ingénieurs expérimentés en thermoanalyse, chimie des matériaux et formulation,
- d’une connaissance approfondie de nombreuses matrices : polymères, principes actifs, résines, cosmétiques, protéines, matières grasses, etc.,
- d’équipements complémentaires pour corréler les données thermiques à des résultats mécaniques ou chimiques (ATG, FTIR, HPLC, MEB…).
L’analyse DSC devient ainsi un outil décisionnel, permettant par exemple d’identifier des transitions complexes, de comparer des profils thermiques ou de confirmer la conformité à un profil de référence.
Des équipements performants accessibles via un réseau européen
Grâce à son réseau de plus de 200 laboratoires partenaires en France et en Europe, YesWeLab met à votre disposition :
- des DSC étendus en température (jusqu’à 700 °C) avec des modes standard et modulés (MDSC),
- des options avancées de refroidissement, pression contrôlée ou couplage technique,
- des protocoles personnalisés selon la nature de la matrice et les objectifs d’analyse.
Quel que soit votre besoin — contrôle qualité, dossier réglementaire, développement produit ou recherche appliquée —, YesWeLab vous propose la solution analytique la plus adaptée via un guichet unique digitalisé.
Gain de temps, de fiabilité et de conformité
Passer par YesWeLab, c’est aussi s’assurer :
- d’un délai rapide, souvent sous quelques jours ouvrés, même en urgence,
- d’une conformité réglementaire : nos laboratoires partenaires sont accrédités ISO 17025 et leurs rapports sont acceptés par les autorités (ANSM, EFSA, REACH, etc.),
- d’une traçabilité complète : protocoles, résultats et interprétations sont sécurisés et audités,
- d’une confidentialité garantie, avec protection de vos données sensibles.
Vous évitez ainsi les erreurs d’analyse, les retards dans vos dossiers réglementaires et les non-conformités en production.
Un accompagnement personnalisé de bout en bout
YesWeLab ne se contente pas de transmettre des résultats. Notre approche est centrée sur l’accompagnement client, avec :
- une aide à la définition du besoin analytique et au choix des paramètres DSC,
- la validation de protocoles adaptés à vos matrices,
- des conseils techniques pour optimiser vos formulations ou procédés,
- un suivi réactif à chaque étape du projet.
Grâce à notre plateforme digitale, vous pilotez vos demandes d’analyses DSC simplement, de la commande à l’exploitation des résultats.
Cas d’usage : quand faire appel à une analyse DSC ?
Voici quelques cas concrets dans lesquels YesWeLab vous accompagne efficacement :
- Contrôle qualité d’un lot de polymère avant transformation,
- Validation thermique d’un matériau composite pour l’aéronautique,
- Optimisation de la stabilité d’une formulation cosmétique ou nutritionnelle,
- Analyse d’un écart thermique détecté lors d’un vieillissement accéléré.